| Les cisterciens,
une "formidable épopée spirituelle" |
Le contexte
Les vives critiques dont sont l'objet les moines de Cluny (richesses excessives, relâchement de la discipline, éloignement de la règle de Saint Benoit, ...) débouchent sur le développement de nouvelles communautés prônant le renoncement de soi et la méditation. C'est dans ce contexte de retour aux principes fondamentaux tels que les avait décrits Saint Benoit qu'il faut situer les origines du mouvement cistercien.
Les débuts de Cîteaux
Après avoir été moine bénédictin (définition de celui qui suit la règle de Saint Benoit), prieur puis abbé du monastère clunisien de Saint Michel à Tonnerre, Robert fonde en 1075 avec un groupe d'ermites le monastère de Molesmes sur des terres offertes par le seigneur de Maligny près de Châtillon-sur-Seine (entre Chaumont et Auxerre). Très vite ce monastère a un rayonnement considérable, les dons affluent et d'autres communautés viennent s'affilier.
|
Mais le succès et la prospérité de l'établissement l'éloignent de l'idéal monastique : Robert décide en 1090 avec 21 moines bénédictins de Molesmes de quitter cette opulente abbaye et de vivre en ermite pour pratiquer la règle bénédictine dans sa teneur la plus stricte. Il tente sans succès de rétablir 3 années plus tard la règle bénédictine à Molesmes avant de se faire concéder des terres marécageuses et boisées en un lieu nommé "Cistels" (nom qui deviendra par déformation Cîteaux) à 22km au sud de Dijon. Il y crée avec l'aide précieuse d'Albéric et d'Étienne Harding un nouveau monastère en 1098 en redéfinissant les normes concernant la pauvreté individuelle, l'hospitalité et l'équilibre de la vie monastique : les bases de l'ordre cistercien sont lancées ! |
 Photo JFM : Statue de Robert de Molesmes,le fondateur de l'ordre sur le site de Cîteaux (devant l'accueil) |
Mais il est reproché à Robert de ne pas avoir respecté
son voeu de stabilité : le Pape l'oblige à revenir à
Molesmes en 1099 et il confie l'abbatiat du nouveau monastère à
Albéric.
Ce dernier va se démarquer grâce aux faits suivants :
- il placera l'ordre sous la protection du Pape en 1100,
- il fera adopter à ses moines l'habit de laine écrue, ce qui les fera qualifier de "moines blancs" en distinction des "moines noirs" de Cluny,
- il fera consacrer la 1ère église sur le site de Cîteaux en 1106 (voir la plaque qui commémore cet événement ci-après).
L'organisation de l'ordre avec Etienne Harding
Albéric meurt en 1109 et Etienne Harding, co-fondateur de l'ordre, est nommé abbé.
|
A cette époque, les moines vivent dans des bâtiments miséreux et sont soumis à une rude ascèse : de ce fait, les nouvelles vocations se font rares et l'établissement se trouve dans le plus complet dénuement. Mais habile organisateur (il emploiera des laïcs pour aider les moines devenus trop vieux), administrateur expérimenté entretenant d'excellents rapports avec les nobles seigneurs des environs, Etienne Harding assurera une croissance spectaculaire à l'ordre pendant plus de 25 ans.
|
 Photo JFM : Statue d'Etienne Harding sur le site de Cîteaux |
Sous son abbatiat, l'ordre commence à essaimer et 4 abbayes-filles de Cîteaux seront créées :
- La Ferté-sur-Grosne en 1113,
- Pontigny, près de Langres, en 1114,
- Clairvaux (dont le 1er abbé sera Bernard) et Morimond près de Langres en 1115.
L'Ordre cistercien se caractérise par une organisation arborescente : Cîteaux est le tronc principal d'où partent 4 branches que sont les abbayes-filles ; chaque monastère peut à son tour fonder des abbayes, ces dernières étant toujours rattachées à l'une des lignées primitives. C'est ainsi qu'en 1119, l'ordre comptera déjà 12 monastères.
Etienne rédige la Charte de Charité qu'il présente au Pape Callixte II en vue de la reconnaissance de cette nouvelle branche de moines bénédictins : c'est donc à lui que les cisterciens doivent leur statut définitif.
|
La Charte de charité Oeuvre capitale d'Étienne, la charte de charité est
la constitution de l'Ordre qui précise que la Règle
devra être comprise et observée par tous d'une seule
manière et que le mode de vie sera partout semblable. L'idée
de base est de laisser à chaque monastère son autonomie
pour encourager son expansion, tout en maintenant au-dessus de lui
une juridiction d'appel et de surveillance pour l'empêcher
de dévier. La Charte de Charité décrit :
Cette organisation se distingue de celle de Cluny dans laquelle l'abbé de Cluny est le chef de l'ordre et exerce une autorité unique et suprême sur tous les monastères affiliés. |
A sa mort en 1133, Harding laissera un ordre comportant déjà 70 communautés, pour lesquelles il aura contribué à leur organisation.
Bernard de Clairvaux : le maître spirituel
"Elevez-vous par l'humilité, telle est la voie ; il n'y en a pas d'autres" - Saint Bernard
 |
Bernard naît en 1090 et est le fils d'un des seigneurs de Fontaines situé à quelques kilomètres de Dijon. Il bénéficie d'une éducation complète en étudiant les trois disciplines fondamentales : la grammaire, la rhétorique (art de bien parler) et la dialectique (art de raisonner). Attiré par la ferveur de ses moines, il rejoint le monastère de Cîteaux en 1112 accompagné de 30 compagnons dont 4 de ses frères et 2 de ses oncles maternels. Statue de Saint Bernard, église de Fontaine-lès-Dijon |
|
Doté d'une intelligence, d'un dynamisme et d'une sensibilité exceptionnels, il assurera le véritable rayonnement à l'ordre : sa force de conviction et sa notoriété attireront de nombreuses vocations (par exemple, 60 postulants le suivront après son prêche pour la 2ème croisade en 1147). Il lui est confié à seulement 25 ans la charge de créer l'abbaye de Clairvaux en 1115, 3ème abbaye fille de Cîteaux et qui deviendra l'une des plus célèbres abbayes. En 38 ans d'abbatiat, il contribue à la création de 68 abbayes filles de Clairvaux, et sa filiation comptera 165 établissements ! Retable de Clairvaux, musée des Beaux-Arts de Dijon |
 |
Dénonciateur de l'ordre de Cluny : il n'aura de cesse de critiquer :
- les écarts faits à la règle de Saint Benoit : mets surabondants, coquetterie, habitudes et trains de vie princiers,
- le cadre de certains monastères, leur décoration somptueuse,
peintures ou sculptures évoquant des messages bibliques, qui
sont utiles au fidèle mais pas au moine.
Deux citations de Saint Bernard issue de son apologie à Guillaume :- "O vanité des vanités, mais plus insensée encore que vaine : l'église resplendit sur ses murailles et elle manque de tout dans ses pauvres".
- "Sans parler de l'immense élévation de vos oratoires, de leur longueur démesurée, de leur largeur excessive, de leur décoration somptueuse et de leurs peintures plaisantes dont l'effet est d'attirer sur elles l'attention des fidèles et de diminuer le recueillement".
|
Un personnage de 1er plan dans la vie médiévale :
|
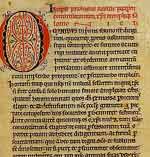 1ère page de la règle du Temple |
A sa mort au milieu du XIIe, il laisse derrière lui plus de 160 moines à Clairvaux, l'ordre compte près de 350 abbayes et la moitié des moines français sont cisterciens !
S'il n'est pas le fondateur de l'ordre de Cîteaux, il aura été sa plus grande gloire et son maître spirituel. Il sera canonisé en 1174 par le pape Alexandre III.
|
L'abbaye de Clairvaux : (près de Langres) Des divers bâtiments construits sur le site, il ne reste que quelques éléments : l'église abbatiale dans laquelle reposait Saint Bernard n'existe plus car elle a été démolie au début du XIXe. Il reste quelques murs du premier Clairvaux (le "Monasterium Vetus"), le splendide bâtiment des convers et le grand cloître du Clairvaux de la Renaissance. Le monastère a servi à divers usages, avant de devenir au début du XIXe ce qu'il est encore aujourd'hui : l'une des prisons centrales les mieux gardées de France (elle accueille 150 prisonniers, tous condamnés à de longues peines ou condamnés à perpétuité sans date de sortie fixée). |
L'austérité de l'architecture cistercienne
L'architecture cistercienne s'est affirmée au XIIe, au moment de l'épanouissement de l'art roman. L'ordre prône une architecture austère, mais cette sobriété et son dépouillement est l'expression d'une morale et du respect de la théologie : le luxe et le faste sont bannis et tout élément de décoration jugé superflu est supprimé (sculptures ou peintures notamment). Seules des feuilles d'eau faisant référence à l'origine de l'ordre sont fréquemment représentées sur des chapiteaux. L'absence de clocher dans les églises des monastères traduit très bien ce refus de toute marque ostentatoire de puissance.

Photo JFM : Panoramique de l'abbaye de Fontenay (près de Montbard)
En plus de la réussite spirituelle, l'ordre représente aussi une réussite matérielle et esthétique dont des chefs d'oeuvre nous sont parvenus comme témoignage de la foi et de l'enthousiasme de ces moines médiévaux :
- équilibre parfait de la lumière au niveau du coeur, du transept et de la nef,
- parfaite harmonie des masses et des volumes,
- refus de tout superflu qui accentue une magnifique sobriété.
Les abbayes, généralement implantées dans des sites éloignés, sont toutes construites selon un modèle similaire :
Cloître de l'abbaye de Fontenay |
 |
- le scriptorium : cette salle abrite principalement les travaux d'écriture des manuscrits,
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
La magnifique abbaye de Fontfroide
|
Le pape Benoît XII (1334-1342), ancien moine cistercien, est d'ailleurs à l'origine du "Palais Vieux" d'Avignon : vaste et austère, cette oeuvre reflète ses goûts sobres, caractéristiques de l'ordre des cicterciens.
La suite
Après l'expansion initiée par Bernard de Clairvaux, l'ordre va continuer à croître : de 530 à la fin du XIIe, les cisterciens compteront jusque 700 abbayes au XIIIe.
Mais différents facteurs vont perturber cette croissance exceptionnelle :
- Enrichissement de l'ordre : les moines cisterciens faisant preuve d'une exceptionnelle maîtrise des techniques agricoles et métallurgiques, leurs abbayes vont devenir florissantes et dégager des surplus qui seront commercialisés. A force de tirer des bénéfices des commercialisations, certaines abbayes vont se transformer en banques et deviennent créancières de la société aristocratique. Cette introduction dans le circuit économique et cette opulence les éloignera des exigences de pauvreté, qui était à la base de Cîteaux. Cet enrichissement favorisera entre autres le développement des ordres mendiants.
- Concurrence des ordres mendiants : ces derniers attirent la plupart des vocations au détriment des ordres traditionnels.
- Mise en cause de l'unité de l'ordre : certaines abbayes tombent en léthargie, d'autres quittent la congrégation, les relations entre mères-filles se distendent et des libertés sont prises pour aménager la règle primitive.
- Système de la commende : à la fin du moyen-âge, le système de la commende retire aux communautés le droit d'élire leur abbé au profit du roi, du Pape ou de l'évêque : les établissements perdent ainsi leur guide spirituel.
- Lois antireligieuses : les lois promulguées pendant la révolution française portent un coup quasi fatal à l'ordre.
Après la révolution, l'ordre réapparaîtra
progressivement et actuellement, l'ordre cistercien de la stricte observance
(OCSO) compte environ 2600 moines répartis dans près de
100 abbayes dans le monde dont 16 en France.

|
|


