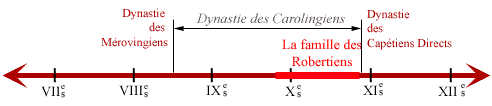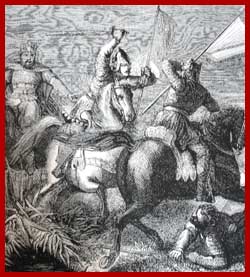| Des règnes
éphémères et le début des Robertiens (877 - 987) |
|
Accueil > Les Carolingiens >La famille des Robertiens |
|
|
Des règnes éphémères : 4 rois en 10 ans
Fils de Charles-le-Chauve, il prend la succession à la mort de son père en 877. Il est maladif, chétif et affligé de bégaiement, l’aristocratie profite donc de sa faiblesse pour arracher à la monarchie de nouvelles concessions. Il meurt alors qu’il prépare une expédition contre les comtes de Poitiers et du Mans. Il laisse deux fils d’un 1er mariage, Louis III et Carloman, et sa 2ème épouse est enceinte d’un fils, qui sera Charles-le-Simple : ils deviendront tous les trois rois ! Louis II le Bègue après
son couronnement |
 |
- Louis III (879 – 882)
Il accepte, ce qui est rarissime dans l’histoire des rois, de partager
le pouvoir avec son frère Carloman : il gouverne la Neustrie et
l’Austrasie, et laisse à son frère la Bourgogne, l’Aquitaine
et la Septimanie (Narbonne, Carcassonne, Béziers et Nîmes).
Après avoir remporté une victoire sur les vikings, il meurt
sans descendance en 882 et laisse le royaume à son frère
Carloman.
- Carloman (879 – 884)
Jeune et inexpérimenté, il laisse ses conseillers et le comte de Paris Eudes, fils de Robert-le-Fort, gouverner à sa place. Il meurt à son tour en 884 d’une blessure de chasse, sans aucune descendance. Son demi frère Charles-le-Simple n’ayant que 5 ans, les grands du royaume proposent la couronne à Charles-le-Gros, déjà roi d’Allemagne et d’Italie : il est l'oncle des 2 précédents rois (voir l'arbre généalogique des carolingiens).
- Charles-le-Gros (884 – 887)
Grâce à la régence accordée par les grands
du royaume, il contrôle quasiment le même territoire que son
arrière grand-père Charlemagne.
Mais, qui plus est obèse et épileptique, il se montre indigne
de ses responsabilités :
- Il achète à prix d’or la paix avec les vikings au lieu de leur tenir tête,
- Il dépouille les nobles autrichiens,
- Il fait exiler sa sœur et crève les yeux d’un neveu rebelle,
- Il est à la fois rejeté par les nobles français qui désignent en 887 un non carolingien, le comte de Paris Eudes, et par les nobles allemands qui le font enfermer dans une abbaye.
Il y aura donc eu 4 rois en 10 ans ! (voir l'arbre généalogique ... pour mieux se repérer).
Un 1er roi non carolingien : Eudes (888 - 898)
Après les règnes éphémères et peu énergiques de LouisII-le-Bègue puis de ses fils Louis III et Carloman puis de son cousin Charles-le-Gros déposé en 887, il fallait un homme fort capable de juguler l'anarchie ambiante : Eudes, comte de Paris, d'Anjou et de Touraine sera ainsi élu roi en 888, remettant en cause le principe d'hérédité du trône. Il est donc désigné roi de France au détriment de Charles-le-Simple, dernier héritier carolingien.
Il est fils de l’illustre Robert-le-Fort, qui a défendu le royaume contre les vikings en 853 : ce dernier est à l'origine de la lignée des Robertiens, et il est l'arrière grand-père d'Hugues Capet qui donnera son nom à la dynastie des Capétiens.
|
Eudes s’est déjà illustré à deux reprises contre les vikings :
Le
comte Eudes défend Paris contre les Normands |
 |

Photo : merci Olivier P !
Cette plaque commémorative est localisée sur le parvis de
la cathédrale Notre-Dame-de-Paris,
à l'entrée de la crypte : elle illustre les durs combats
menés par le Comte Eudes et ses compatriotes contre les vikings.
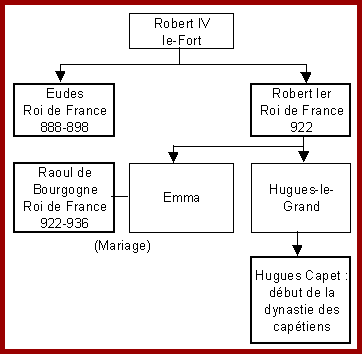 |
Eudes meurt en 898 et Charles-le-Simple devient roi : la couronne revient aux carolingiens, comme il avait été acté car certains seigneurs contestaient que le dernier descendant posthume de LouisII-le-Bègue ait été écarté de la succession : mais la famille des robertiens continuera à tisser sa toile ! |
Charles-le-Simple (898 – 923)
Il devient enfin roi de France après que le trône lui ait été refusé à deux reprises :
- une première fois à l’avantage de son oncle Charles-le-Gros en 884,
- puis en 888 avec Eudes,
Son qualificatif signifie « loyal » et non pas « sot », mais il ne fait pas preuve d'une capacité politique remarquable… Il est impuissant face aux seigneuries féodales qui se renforcent à l’abris de leurs châteaux-forts et il leur accorde des concessions qui les renforcent davantage.
|
Le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec
les Vikings
|
|
Il se montre par contre diplomatique pour résoudre le problème viking avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911 (ces négociations ont été entamées avec Eudes) : En effet, les normands, commandés par Rollon sont très profondément ancrés sur la Somme, la Seine et la Loire. Charles III-le-Simple et les évêques ont la bonne idée de proposer à Rollon l’installation des hommes du nord dans les 3 diocèses de Rouen, Evreux et Lisieux. Le duché de Normandie vient de naître, et deviendra grâce au zèle de ses dirigeants l’un des plus puissants de France. Au titre de cet accord, leur chef Rollon se fait baptiser, épouse la fille de Charles-III-le Simple et adopte des principes à la fois francs et scandinaves. Une anecdote : Rollon, dédaigneux envers Charles-le-Simple, fait rendre l’hommage par l’un des siens : devant baiser son pied, ce dernier le prend pour le porter à la bouche plutôt que de s’agenouiller, jetant ainsi le roi à la renverse, ridiculisant encore Charles-le-Simple devant les nobles présents ! |
La prise de contrôle par les robertiens
|
En 922, les aristocrates menés par le frère d'Eudes, Robert Ier, se coalisent, désignent comme nouveau roi Robert Ier et renversent Charles-III-le Simple : le roi déchu contre-attaque et durant la bataille qui oppose en 923 à Soissons les deux armées, il fait preuve d’une grande bravoure. Robert Ier est tué mais son fils Hugues-le-Grand parvient à ranimer le courage de ses soldats et à mettre en déroute l’armée de Charles-le-Simple. Le roi se réfugie chez un de ses vassaux et sa seconde épouse s’enfuit en Angleterre avec leur jeune fils, qui sera le futur roi Louis IV d’Outre-Mer. |
|
C'est Raoul, duc de Bourgogne et gendre de
Robert Ier, qui est élu roi en 923.
Il se défendra entre autres face aux incursions hongroises (926)
et normande (930), et aura la dure tâche de s’imposer face
aux vassaux qui se permettent de battre leur propre monnaie. Il meurt
en 936 sans descendant et son frère Hugues-le-Grand installe sur
le trône le fils de Charles III-le-Simple qui avait été
exilé en Angleterre, Louis IV d'Outre-Mer
(voir l'arbre généalogique
... car ça se complique ...).
| A la mort du roi Louis IV d'Outre-Mer en 954 , Hugues-le-Grand laisse
monter sur le trône le fils du roi, Lothaire,
âgé de seulement 13 ans. Le roi reste sous la tutelle
de Hughes-le-Grand qui en profite pour s’octroyer les duchés
d’Aquitaine puis de Bourgogne. Il meurt en 986, probablement empoisonné par sa femme : son fils Louis V lui succède. |
Hugues-le-Grand C’est un homme de pouvoir et un fin manipulateur : plutôt que de revendiquer la couronne, il préfère la faire porter à une personne qui lui est dévouée. Il devient également l’oncle de Louis IV en épousant la sœur de sa mère. |
Louis V meurt à son tour seulement 15 mois après être
monté sur le trône d’une chute de cheval lors d’une
partie de chasse. Il n’a pas d’héritier et le dernier
carolingien, son oncle Charles, duc de Basse-Lorraine, est détesté
de tous les nobles, qui lui préfèrent Hugues
Capet, fils de Hughes-le-Grand. Hugues Capet
se fait ainsi élire roi en 987, mettant fin à la dynastie
des carolingiens et inaugurant pour 8 siècles celle des capétiens.
Comme les Pippinides avaient progressivement pris le pouvoir aux mérovingiens, les robertiens auront fait de même aux carolingiens.
|
Le développement de l'ordre de Cluny Au début du règne des carolingiens, les monastères ne respectent plus la règle de Saint Benoit : pour obliger les monastères à respecter ses principes fondamentaux, Louis le Pieux imposera par le capitulaire de 817 la règle bénédictine à tous les monastères ... mais sans grand succès. |
|||
|
Dans le contexte de délabrement global de la vie monastique, le duc d'Aquitaine et comte de Mâcon Guillaume cédera en 909 à l'abbé Bernon un domaine dans la Saône pour qu'il y fonde le monastère de Cluny sous le patronage des apôtres Pierre et Paul, et qui sera libéré de toute tutelle laïque. L'ordre de Cluny connaîtra un essor extraordinaire : au XIIe, environ 300 établissements avec près de 10000 moines y seront affiliés en Europe, une densité jamais atteinte pour un ordre monastique !
|
|||
 |
|